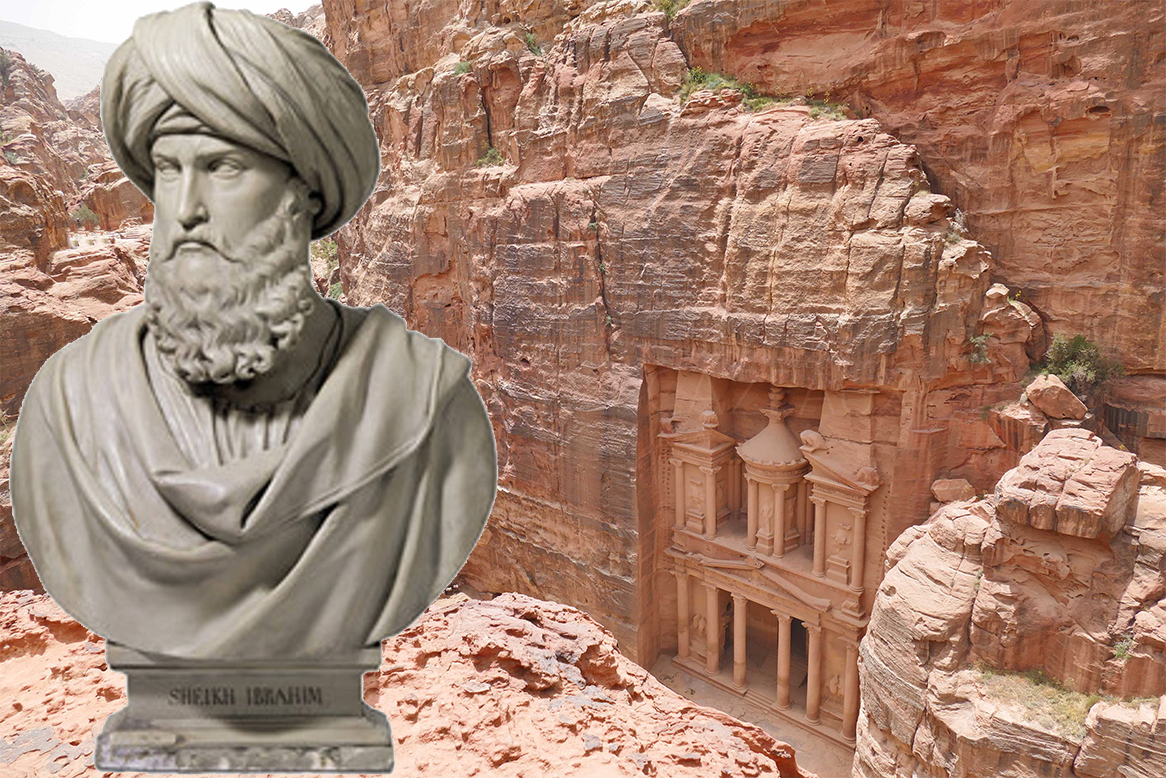Il est devenu classique, désormais, de distinguer deux phases dans ce domaine : une première marquée par la prépondérance des éléments orientaux et archaïques et une deuxième pendant laquelle Carthage commence à s’ouvrir largement aux courants d’influence hellénistique.
Les dieux et les cultes
Intensément croyants, les Carthaginois adoraient plusieurs divinités organisées en un panthéon aussi riche que complexe. La plupart de leurs dieux bien qu’originaires de Phénicie, apparaissent fortement marqués par des influences locales et méditerranéennes diverses. Melqart, patron de Tyr, assimilé à Héraklès par les Grecs, était protecteur de Carthage et jouissait d’un culte important. Eshmoun, dieu guérisseur et équivalent punique de l’Esculape latin, était adoré dans un majestueux sanctuaire qui fut, au sommet de la colline de Byrsa, le dernier bastion de la résistance punique aux assauts romains de 146 avant J.-C.
Cependant deux divinités finirent par dominer toutes les autres et par régner sur le panthéon punique : Baâl Hammon et Tanit. Il est curieux de noter qu’elles ne furent l’objet d’aucun culte important en Phénicie. Connaissant l’attachement des Puniques à leurs traditions nationales, les historiens de la religion ont proposé d’identifier Baâl Hammon à El, le père des dieux en Phénicie ; et, dans ce cas, sa parèdre Elat ou Asherat serait Tanit. On explique le fait que ces deux divinités n’aient pas été adorées à Carthage sous leur véritable nom par une tendance à éviter de prononcer le nom du dieu, chargé d’une trop grande force sacrée et à le remplacer par des épithètes.

Cependant, malgré d’importants progrès dus à l’exploitation littéraire des auteurs classiques, aux apports des plus récentes trouvailles archéologiques et aux multiples études actuelles, on n’est pas encore en mesure de combler certaines lacunes dans notre connaissance de la religion punique. Pour certains Baâl Hammon résulterait de la fusion de deux divinités, l’une phénicienne et l’autre africaine. Pour d’autres, son nom serait bien phénicien et signifierait « Le seigneur des autels à parfums » (Baâl signifiant seigneur et Hammon autel à encens ou brûle-parfum). A l’appui de cette deuxième thèse on peut invoquer le rôle très important de l’offrande d’encens dans le culte punique et la persistance de cette pratique pour Saturne, successeur de Baâl Hammon, à l’époque romaine. Toutefois la racine sémitique HMN évoque la notion de protection et Baâl Hammon apparaît comme le dieu protecteur de la cité par excellence. C’était aussi un dieu solaire, garant de prospérité et de bien-être. Malgré la répugnance traditionnelle des Sémites à prêter à leurs divinités des apparences humaines et en dépit de l’absence des types canoniques précis comme ceux adoptés par les Grecs ou les Romains pour leurs dieux, on a pu identifier, avec plus ou moins de certitude, Baâl Hammon et même Tanit sur certains monuments puniques.
C’est ainsi qu’une statuette en terre cuite d’époque romaine trouvée dans les ruines d’un sanctuaire de Thinissut près de Bir Bou Regba, représente Baâl Hammon barbu, assis sur un trône flanqué de deux sphinx, la tête coiffée d’une tiare de plumes, la main droite ouverte et levée. Le même dieu apparaît sur une stèle du tophet de Sousse, coiffé d’une tiare conique, tenant une lance et assis sur le trône aux sphinx face à un adorant auquel il semble donner la bénédiction en levant la main droite.
Baâl Hammon: C’est sans doute Baâl Hammon aussi qui est représenté sur une bague d’or trouvée à Utique, et sur de nombreuses terres cuites de Carthage. C’est à lui seul qu’on dédia les plus anciennes inscriptions sur cippes du tophet de Salammbô et il occupa pendant longtemps le premier rang devant sa parèdre Tanit dite « Pené Baâl » ou « face de Baâl » voire « tenant le rôle de Baâl », ce qui semble signifier qu’elle lui était subordonnée à l’origine. D’ailleurs, en Phénicie, la divinité mâle a toujours eu la préséance sur la femelle.

Cependant une curieuse révolution spirituelle se produisit à Carthage au cours du Ve s. faisant passer Tanit, semble-t-il, au premier rang. Tanit pose encore plus de problèmes que Baâl Hammon ; son nom est inexpliqué et semble d’origine libyque si l’on tient compte du fait que dans les langues berbères les noms féminins commencent et se terminent par « t ».
On pensait qu’elle aussi résultait de la fusion entre une divinité phénicienne qui serait Elat ou Asherat et une déesse africaine de la fertilité. Devenus agriculteurs, les Puniques auraient paré Asherat d’attributs empruntés à la déessemère dont le culte était alors très en vogue en Méditerranée.
Aujourd’hui ses origines orientales paraissent plus sûres grâce à des documents trouvés dans la région de Sidon. Les Grecs l’ont identifiée avec Héra et, d’une manière générale, elle fut adorée comme déesse de la fécondité présidant aux moissons et protégeant les accouchements. Son caractère chtonien et fécond est souligné sur de nombreuses stèles par la représentation de grenades, de figues, d’amandes, de palmiers, de colombes, de poissons.
La lune figure aussi parmi ses nombreux symboles, car Tanit était également adorée comme une déesse céleste. Certaines dédicaces la qualifient de « mère » et de « dame » ; elles étaient généralement ainsi conçues : « À la Mère, à la Dame, à Tanit Pené Baâl… ». Nous ne disposons d’aucune inscription nous permettant d’identifier d’une manière sûre une Tanit représentée par une statue ou figurée sur une stèle ou un cippe.
On croit cependant reconnaître l’image de la déesse sur un certain nombre de monuments. On l’a représentée en femme pressant ses seins, en femme nue et ailée, en déesse assise sur un trône dont les accoudoirs étaient sculptés en forme de sphinx. Ce dernier type a survécu jusqu’à l’époque romaine et on a trouvé dans les sanctuaires de Thinissut et d’El Kenissia, à côté de la déesse, des sphinx avec des seins accentués et portant les bretelles croisées de la déesse mère pour rappeler le caractère chtonien de Tanit. Cependant, notre divinité était plus couramment représentée par des symboles dont le plus célèbre est le « signe dit de Tanit ».
C’est généralement un triangle surmonté d’une barre horizontale et d’un disque suggérant la silhouette d’une divinité bénissante. Quant au « signe de la bouteille », symbole assez fréquent de Tanit, il représenterait d’une manière schématique une silhouette féminine à la poitrine et au bassin accentués. Les Carthaginois adoraient également de nombreuses autres divinités comme Astarté (Aphrodite), Reschef (Apollon), Shadrapa (Bacchus), Yam (Poséidon) et Haddad (Arès). Il faut enfin signaler les larges emprunts que les Puniques firent à l’Egypte et la popularité dont jouirent certaines divinités égyptiennes comme Isis, Osiris et Bès dans le monde carthaginois. De même les déesses grecques Déméter et Coré, introduites dans la métropole punique en 396 avant J.-C., furent l’objet d’un culte fervent. Les divinités libyques étaient sans doute présentes à Carthage.

La religion punique était servie par un clergé nombreux, fortement organisé et dont les membres se recrutaient parmi les familles aristocratiques les plus renommées. De nombreuses femmes ont été investies de dignités religieuses. Bien que jouissant d’un grand prestige, les prêtres n’ont jamais formé de caste ni prétendu exercer quelque influence politique importante. Ils ne semblent pas non plus, avoir disposé d’attributions en matière de justice, d’instruction, de surveillance des mœurs ou de direction des consciences. Attachés aux temples, ils se contentaient de célébrer le culte et de présider aux cérémonies religieuses et aux sacrifices.
Les « Tophets » et les pratiques funéraires
La réputation faite aux Carthaginois de pratiquer largement les sacrifices humains, avait suscité l’horreur et la révolte de leurs contemporains grecs et romains. Ces pratiques étaient connues chez certains peuples de l’ancien Orient qui les jugeaient nécessaires pour s’attirer la faveur des dieux. On croyait couramment en Orient que le roi, en particulier, possédait une sorte d’énergie sacrée indispensable à la vie de la communauté. Il était donc nécessaire qu’il se sacrifiât lui-même, au bout d’un certain nombre d’années de règne, pour communiquer à la nature l’énergie qu’il détenait. Il assurait ainsi, par la régénérescence des forces naturelles, salut et prospérité à sa patrie. C’est dans ce sens qu’il faut peut-être interpréter le geste légendaire d’Elissa se jetant dans le feu. Les successeurs de la célèbre reine de Carthage n’ont pas dû échapper à cette terrible exigence selon certains.
Cependant, peu à peu, une mystique nouvelle fit substituer au roi une autre victime. Celle-ci devait être aussi proche que possible du dédicant, donc généralement son fils, qu’il offre tout en étant censé se sacrifier lui-même. Lorsque le régime monarchique disparut de Carthage et fut remplacé par la République, les membres du Sénat se trouvèrent dans l’obligation de sacrifier leurs fils aînés, généralement en bas âge. D’ailleurs cette pratique se serait étendue petit à petit à tous les nobles et même aux masses populaires, au fur et à mesure que les institutions se démocratisaient. Les sacrifices revêtaient un caractère particulièrement impérieux en cas de défaites militaires ou de catastrophes quelconques.

On estimait que la charge du sacré sur la ville s’était affaiblie, et on sacrifiait les enfants pour revigorer les dieux protecteurs de la patrie. C’était aussi une façon de confesser ses fautes aux dieux et de les expier. En 310, nous raconte Diodore de Sicile, alors que Agathocle poursuivait la conquête de leur territoire, les Puniques prirent conscience de la gravité de la situation, attribuèrent leurs revers à la colère des dieux et décidèrent de se racheter en sacrifiant deux enfants choisis dans les familles les plus nobles. Trois cents autres citoyens offrirent volontairement leurs enfants probablement parce qu’ils avaient mauvaise conscience.
La description par Diodore de cette cérémonie au cours de laquelle tous ces enfants, préalablement égorgés ou étouffés, furent livrés aux flammes, inspira à Flaubert son célèbre chapitre, « Moloch », dans « Salammbô ». Il semble qu’on sacrifiait souvent aussi pour faire cesser la sécheresse ou promouvoir la fertilité. Nombreuses sont les stèles où figurent des symboles de fertilité et de fécondité comme le palmier, l’olivier, le grenadier, ou encore certains animaux. Partant du principe que les dieux ont droit à une part de tous les produits, on a pu penser aussi qu’en leur offrant le premier-né des enfants, on pourrait jouir plus tranquillement du reste de la progéniture. Pour donner à l’acte toute sa valeur, on exigeait des parents d’assister au sacrifice de leurs enfants.
Ces sacrifices, mentionnés par quelques textes seulement, ont été rendus plausibles par la découverte, notamment à Carthage et à Sousse, de tophets ou enceintes sacrées, à l’intérieur desquelles les Puniques enterraient leurs enfants. A l’origine, ce nom de tophet a été donné par la Bible à un endroit précis de la banlieue de Jérusalem où les Israélites faisaient des sacrifices humains. Le tophet de Carthage se développa autour et au-dessus d’un monument primitif constitué par un dépôt contenant de la céramique égéenne du VIII e s. et protégé par une chapelle. On pense qu’il y avait à cet endroit même un tombeau de roi ou de héros dont le culte aurait subsisté pendant longtemps.
En tout cas on a cru que c’est dans ce tophet que, pendant près de six siècles, les Carthaginois avaient égorgé, brûlé et enterré leurs enfants. Flaubert avait décrit ces cérémonies sanglantes à sa manière, cherchant ostensiblement, à épouvanter le lecteur : « Ees bras d’airain allaient plus vite. Ils ne s’arrêtaient plus… Ees victimes, à peine au bord de l’ouverture, disparaissaient comme une goutte d’eau sur une plaque rougiè et une fumée blanche montait dans la grande couleur écarlate. Cependant l’appétit du dieu ne s’apaisait pas. Il en voulait toujours. Afin de lui en fournir davantage, on les empila sur ses mains avec une grosse chaîne par-dessus qui les retenait ». Comme on peut le voir, Flaubert a entièrement lâché la bride à son imagination.
Il a fait du sacrifice une cérémonie tellement horrible que beaucoup de savants ont eu de la répugnance à y croire jusqu’à la découverte des tophets. Pendant longtemps, les savants ont cru que les Puniques sacrifiaient au dieu Moloch ; en fait il a été montré que le mot Molk, très fréquent sur les stèles, désigne le sacrifice lui-même et non une divinité quelconque. Seuls Baâl Hammon et Tanit ont été concernés par les monuments votifs du tophet. Les cendres des enfants brûlés en leur honneur étaient recueillies dans des vases et enterrées dans le tophet à des emplacements marqués par des cippes et des stèles. Quand tout l’espace se remplissait et que la place venait à manquer, on remblayait tout et on passait à un niveau supérieur.
Le tophet est, ainsi, fait de couches superposées de terre, d’urnes et d’ex-votos. Fouiller un tel monument, c’est fatalement le détruire. Cependant dans le cas de Carthage, les archéologues ont réussi à laisser quelques buttes témoins qui montrent aux visiteurs l’évolution du tophet. C’est ainsi qu’au fur et à mesure qu’on passe des couches inférieures aux couches supérieures, on voit des sortes de sarcophages en grès stuqué succéder à de véritables petits dolmens ; puis apparaissent les urnes directement enfouies dans le sol. Les monuments votifs suivent également une évolution intéressante.

Au VIe s. on a utilisé des cippes en grès sculpté imitant des temples égyptiens ou présentant l’aspect d’un trône portant un ou plusieurs bétyles. A la fin du Ve s. c’est l’influence grecque qui commence à se manifester à travers des cippes pilastres coiffés de chapiteaux doriques ou ioniques. Enfin dans les couches supérieures, on adopte les obélisques et surtout les stèles. Celles-ci portent généralement des inscriptions et un décor gravé représentant des motifs religieux ou prophylactiques : prêtre portant l’enfant destiné au sacrifice, animaux, matériel cultuel, symboles et attributs divins, signes de Tanit et de la bouteille etc…. Plus tard, à l’époque néo-punique, on substitue des animaux aux victimes humaines en indiquant que c’était « anima pro anima, sanguine pro sanguine, vita pro vita » (âme pour âme, sang pour sang et vie pour vie).
Il semble cependant que ce sacrifice de substitution ou « Molchomor » attesté par les stèles de N’gaous (en Algérie), ne soit qu’une partie d’un rite plus complexe qui vise essentiellement à obtenir une naissance. Aujourd’hui, de nombreux savants commencent à se demander si l’on peut continuer à voir en ces tophets des espaces de « meurtres sacrés » en l’honneur des dieux. Déjà, au moment de la découverte du sanctuaire de Carthage, un éminent historien, Charles Saumagne, avait réagi contre les interprétations abusives des archéologues et du public en écrivant : « l’imagination du public que hante le souvenir de Flaubert a promptement dramatisé la découverte : ces enfants, a-t-on dit et écrit aussitôt, ce sont les victimes des cruels holocaustes que Carthage offrait à Moloch. Voilà un pas qu’il est imprudent et grave de franchir à la légère… Nos nerfs s’irritent et réagissent à l’idée que rituellement des mères ont pu livrer au feu un enfant pour acquérir des mérites ».
La prudence s’impose d’autant plus que ces pratiques ont été rapportées essentiellement par Diodore de Sicile et Plutarque, auteurs connus pour leur hostilité envers Carthage alors que d’autres écrivains anciens parmi les plus célèbres et les mieux renseignés sur la métropole punique comme Hérodote, Thucydide, Polybe, Tite-live n’ont fait aucune allusion à ce genre de sacrifices. D’un autre côté, les analyses faites au cours des dernières décennies, si elles ont confirmé la présence dans les urnes d’ossements calcinés d’enfants très jeunes morts-nès ou morts en très bas âge, ne permettent guère de savoir si ces enfants ont été incinérés après une cérémonie de sacrifice ou au terme d’une mort naturelle.
Enfin on a constaté que les tombes d’enfants dans les nécropoles de Carthage étaient, sinon totalement absentes, du moins d’une rareté extrême alors que la mortalité infantile était très élevée. Face à tous ces arguments d’éminents savants ont proposé de considérer le tophet comme un cimetière d’enfants morts de manière naturelle mais prématurée et voués de ce fait aux dieux suprêmes de Carthage. Les stèles votives consacreraient une soumission à la volonté divine et en même temps un appel à ces divinités pour jouir du restes de la progéniture et bénéficier d’autres naissances.
Les pratiques funéraires étaient fort diverses. En règle générale on inhuma les morts avant le Ve s. puis, à partir de cette époque et sous l’influence grecque, on commença à les incinérer. Au début, les tombes étaient de vastes chambres dont l’entrée était bloquée par une dalle et les morts étaient généralement déposés dans des sarcophages de bois ou de pierre, s’ils ne gisaient à même le sol. On utilisa ensuite les puits funéraires où étaient enterrés un, deux ou plusieurs morts. Enfin, dans les derniers temps, on eut recours à des mausolées pour les morts illustres. On employa aussi de nombreux sarcophages en marbre dont les couvercles portaient parfois une ornementation d’un grand intérêt iconographique.
L’incinération, particulièrement répandue à Carthage à l’époque hellénistique surtout, n’était pas courante ailleurs. En dehors de la métropole et notamment dans le Sahel et le Cap Bon, l’inhumation des morts dans des hypogées creusés dans le rocher était de règle. Des puits à escalier permettaient d’accéder à une ou deux chambres funéraires aménagées dans les parois. Parmi les rites les plus fréquents on peut noter l’application sur les morts de l’ocre rouge rappelant la couleur du sang et se fixant sur les os après la décomposition des chairs. De même on remarque la pratique de l’enterrement en position latérale contractée dite fœtale et caractérisée par une flexion complète des membres inférieurs, obtenue sans doute par un ligotage préalable du cadavre, position rappelant l’origine de la vie et augurant pour le défunt d’un renouveau vital. Ces pratiques relèvent de traditions libyennes.
En revanche, dans les tombes à inhumation de Carthage et d’Hadrumète, fortement marquées par le sceau de la Phénicie, les squelettes sont toujours allongés sur le dos. Les chambres funéraires contenaient parfois un matériel très riche ; mais généralement il était constitué d’objets courants comme Les, poteries, diverses,, les statuettes, les amulettes etc. Il est possible que les Puniques aient cru en la survie des morts. Nos informations à ce sujet sont trop vagues et nous ne pouvons que demeurer dans le domaine des hypothèses. En tout cas il n’y a rien eu de comparable à ce qui se passait en Egypte ancienne où l’on vouait un véritable culte aux morts.
Au total, si la religion de Carthage contient certains éléments empruntés à l’Égypte ou à l’Afrique, elle subit aussi l’influence de l’hellénisme qui connut un rayonnement exceptionnel dans tout le bassin méditerranéen à partir du IVe s. Comme l’a montré G.-Ch. Picard, le mysticisme hellénistique offrait des perspectives beaucoup plus consolantes que la religion de Carthage dans la mesure où des divinités comme Dionysos, Aphrodite et Déméter apparaissaient plus humaines, plus secourables, servies, par des prêtres qui ne sont pas des fonctionnaires désignés par la cité, mais le plus souvent des mages et des poètes errants qui forment des thiases ouverts « aux étrangers, aux esclaves, à tous les isolés qui fourmillent dans les grandes villes hellénistiques en marge de cadres sociaux réguliers… leur seul espoir est, qu’en une autre vie, un thiase éternel, transporté dans les hauteurs du ciel, leur fera goûter sans terme les joies de ces orgies ».
Carthage, ville cosmopolite par excellence, accueille largement ces cultes aux perspectives si mystérieuses et si douces. En tout cas il est certain que les Puniques importèrent de Sicile pour le rendre officiel le culte de Déméter et Coré, divinités agraires, et de Dionysos, assimilé à Shadrapa, et dont les symboles ne tardèrent pas à apparaître sur les stèles du tophet associés à ceux de Baâl Hammon et de Tanit. De même, Hannibal paraît ouvert aux influences grecques si l’on se réfère au pacte qu’il passa avec Philippe V de Macédoine au lendemain de Cannes.
La vie artistique et intellectuelle
En dépit des destructions et des pillages systématiques subis par Carthage en 146 avant J.-C. et qui ont privé les historiens d’une masse de documents susceptibles de mener à une bonne connaissance de la civilisation punique, on est en mesure, aujourd’hui, grâce aux nouvelles découvertes et aux progrès des recherches et des études, d’apporter d’importants éclairages sur la vie intellectuelle et artistique de cette grande métropole africaine. Le rôle de celle-ci, sans être tout à fait comparable, à celui de la Grèce ou de Rome, n’en est pas moins considérable.
Grâce à des liens étroits et multiformes noués avec la plupart des pays du monde antique, Carthage devint un véritable creuset des civilisations de l’époque. Nantie d’un précieux legs oriental, elle a notamment réussi à développer un art fait de créations propres et d’emprunts à un riche répertoire méditerranéen. L’architecture punique demeure relativement mal connue du fait des destructions déjà évoquées et de l’expansion de l’urbanisme romain au détriment des édifices antérieurs. Toutefois, les fouilles de Carthage et surtout de Kerkouane ont été d’un apport considérable dans ce domaine. Elles ont montré que dans ces deux villes, les trames urbaines procédaient de plans géométriques, rigoureux et étaient agrementées de vastes places aux fonctions économiques, sociales et politiques.
À l’intérieur de ces espaces, les édifices privés et à un degré bien moindre publics, commencent à être mieux connus. Les maisons s’ordonnaient toujours autour d’une cour centrale, parfois agrémentée d’un péristyle, et flanquées, côté rue, de boutiques et d’ateliers. Équipées de citernes et de puits, elles disposaient d’éléments de confort comme les baignoires assez élaborées de Kerkouane. De leur côté, les temples étaient sans podium ni pronaos mais organisés autour d’une cour, avec ou sans portiques, et comprenant au fond une cella principale et deux cellae latérales. Ces sanctuaires à enclos favorisaient le déroulement de processions adaptées au rituel liturgique de la religion punique. Ce type de maison et de temple survécut à la destruction de Carthage et se maintint dans le pays à l’époque romaine et même beaucoup plus tard.
La même pérennité devait caractériser les modes et les matériaux de construction en vogue à l’époque punique : notamment les techniques de la brique crue et du pisé avec coffrage en bois et de Yopus africanum, procédé caractéristique du pays qui consistait à conforter les murs en moellons par des harpes posées verticalement à égale distance les unes des autres.
De nombreux autres documents fournissent de précieux compléments d’information sur l’architecture et l’art puniques. Il s’agit de centaines de cippes et de stèles à caractère architectural et des exvoto en forme de petites chapelles déposées par les fidèles dans les temples et qui sont conçues à l’image àe ceux-ci.
Les stèles et les cippes du tophet de Carthage dénotent au début une grande fidélité à l’héritage oriental puis, à partir du IVe s., ils portent la marque d’emprunts fait à l’archaïsme grec, avec un penchant pour le style éolien. L’ordre ionique ne connaîtra une certaine vogue qu’au IIIe s. et caractérisera notamment le décor architectural des portiques circulaires du port de guerre de Carthage. Cependant le modèle réduit de temple le plus suggestif de l’art monumental de la métropole punique demeure le « naïskos » de Thuburbo Majus, chapelle en miniature dédiée en ex-voto à Déméter (exposé au musée du Bardo). Comme pour l’architecture, destructions et pillages limitent considérablement le champ des connaissances sur la sculpture punique.
Cependant deux documents donnent une haute idée du niveau atteint dans ce genre d’activité artistique. Il s’agit de deux grands sarcophages mis au jour dans la nécropole dite de SainteMonique / Saïda à Carthage et dont les couvercles sont décorés de deux personnages en haut-relief remarquables par leur grande finesse d’exécution et leur puissant intérêt iconographique. De leur côté, les stèles dont les canons diffèrent de ceux de l’art classique, sont intéressantes dans la mesure où elles sont le reflet d’un savoir-faire authentiquement populaire.
D’une grande simplicité à l’époque archaïque, elles s’ornent du fameux « signe dit de Tanit » au Ve s. Des transformations majeures interviennent, un siècle plus tard : adoption d’un matériau plus dense et plus dur, mieux adapté à la sculpture, et d’un nouveau profil avec un fronton triangulaire et des registres séparés par des oves et des perles ; la dédicace occupe le milieu de la stèle et le registre inférieur, encadré de colonnes à chapiteaux éoliques, est orné de motifs végétaux, animaux ou religieux. Vers le milieu du III e s., le décor incisé remplace le relief et l’art de la stèle atteint son apogée avec notamment le buste d’un éphèbe en chlamyde au visage particulièrement expressif, gravé au trait ainsi que la stèle du prêtre à l’enfant qui dénote une grande maîtrise artistique.

La même maîtrise peut se constater dans l’exécution des hachettes-rasoirs, objets rituels fréquents dans des tombes à partir de la fin du VIL s. et dont l’usage et la destination sont énigmatiques — peut-être les utilisait-on pour des toilettes sacrées — mais qui ne manquent ni d’originalité ni de finesse. Leur décor, incisé et gravé, puise son inspiration aussi bien dans le répertoire oriental et égyptien que classique. Ainsi le dieu Melqart, fréquemment représenté sur ce genre d’objets, est-il tantôt figuré à la manière orientale qui le fait apparaître debout sur un podium, au dessus d’une fleur de lotus, vêtu d’une longue tunique, coiffé d’une tiare ou d’un bonnet conique et tenant une hache, soit autant d’éléments déjà présents sur une stèle des environs d’Alep du IXe s. avant J.-C., et tantôt évoqué en « Heraklès — Melqart » avec la dépouille ou la tête de lion et la massue, selon un modèle inspiré des monnaies grecques. Des motifs végétaux, animaux et divers ornent également ces hachettesrasoirs. Dans le domaine de la tabletterie, sculpteurs et graveurs rivalisèrent d’habileté pour fabriquer toutes sortes d’objets en os ou en ivoire destinés à un usage utilitaire ou décoratif : épingles à cheveux, peignes, bracelets, boites à fard, charnières, manches de miroir, statuettes, plaquettes entrant dans la composition de frises décoratives, masques et taslimans etc.
Souvent, artisans et artistes donnent libre cours à leur propre imagination pour exécuter des œuvres originales, mais on note aussi une grande fidélité aux traditions égyptiennes et orientales qui se prolonge jusqu’à la fin de l’époque punique. C’est ainsi qu’on a trouvé dans une maison tardive de la colline de Byrsa une plaquette représentant en relief une scène d’offrande où un personnage présente à une déesse debout sur un sphinx un vase et un épi, modèle s’inscrivant tout à fait dans la tradition orientale. Que l’objet soit un bien de famille ancien exécuté depuis des siècles et pieusement conservé ou tout simplement une réalisation de la fin de l’ère carthaginoise, il ne témoigne pas moins d’un attachement à la tradition orientale.
Cet attachement est confirmé par les récentes fouilles françaises des tombes de la colline de Byrsa qui ont permis la mise au jour d’un ensemble d’objets en ivoire dont notamment des éléments de plaquettes ajourées ayant pour motif principal un cervidé évoluant au milieu d’un enroulement végétal de palmettes et de volutes. Exécutés à Carthage au milieu du VIP s. avant J.-C., ces objets avaient été inspirés d’exemplaires de Nimrud et de Chypre. Ils faisaient partie du mobilier funéraire d’un artisan qui avait tenu à conserver dans sa tombe des morceaux d’ivoire bruts et des pièces finies qui témoignent de son activité artistique.
En outre, provenant du même secteur et datant de la même époque, une plaquette en ivoire figurant un personnage masculin et un autre féminin dans une attitude d’adoration du disque solaire, dénotent une influence égyptisante nette qui est également présente à travers les peignes ouvragés qui apparaissent dès le VIP s. avant J.-C. Parmi ceux-ci, les modèles gravés les plus anciens semblent rattachables à la tradition ornementale syro-palestinienne, quoique produits à Carthage, voire au sud de l’Espagne. Cependant, il convient de souligner que cet attachement à l’Orient n’a jamais exclu l’ouverture la plus large à toutes sortes d’autres influences méditerranéennes. Carthage s’est également illustrée par une production d’excellente facture dans le domaine de la céramique.
Ce sont surtout les terres cuites et en premier lieu les masques qui se détachent de l’ensemble du travail des potiers. Les plus anciens parmi ces masques ont été trouvés dans un contexte funéraire datable de la fin du VIII e s. avant J.-C. ou du début du VII e : hérités de Phénicie et diffusés par Carthage, ils sont tantôt de type négroïde avec une bouche tordue, tantôt grotesques avec un visage grimaçant et fortement ridé. Placés dans les tombes, ils sont censés protéger les morts contre les démons. À partir du VIe s. avant J.-C., on commence à fabriquer également des masques pleins ou « protomés » où la bouche et les yeux ne sont guère perforés. Les cheveux et la barbe sont figurés par de petits cercles gravés.
A la même époque apparaissent des « protomés » caractérisés par une barbe allongée et creusée en son milieu par une sorte de sillon. Parallèlement à ces types masculins, sont produits des modèles féminins de belle facture. Les uns ont une allure égyptienne notamment par leur klaft, les autres, tout en demeurant fidèles à l’Orient dans leur schéma de base, ne comportent pas moins des traits empruntés à l’art grec archaïque ; enfin une troisième catégorie est dite « rhodienne » tellement elle paraît apparentée à des spécimens fabriqués à Rhodes dès le VIe s. avant J.-C. et diffusés dans tout le monde grec.
Ces « protomés », parfois retouchés au sortir du moule, sont souvent rehaussés de peinture. Le peintre et le décorateur interviennent également pour orner des figurines de terre cuite représentant des « déesses enceintes » de tradition orientale, des statuettes de style égyptisant « d’une raideur de momie » et d’autres où commence à se sentir l’influence ionienne. Le modèle le plus représentatif de cette dernière catégorie est la « déesse au tympanon » caractérisée par des traits moins figés, une chevelure traitée à la manière grecque et des vêtements qui se réfèrent à l’Orient, tout comme le tympanon que la déesse serre contre sa poitrine.
L’influence grecque se fait de plus en plus nette avec l’introduction du culte de Déméter à Carthage à partir de 396 avant J.-C. De nombreuses figurines sont alors produites, représentant la déesse soit assise sur un trône soit en « kernophoros », portant sur la tête un brûle-parfum. D’autres divinités comme Baâl Hammon et Tanit surtout ont été également représentées. Une place à part doit être faite à une grande statuette de déesse de 0,33 m de haut richement décorée, bien conservée et donnant une idée assez précise de la parure féminine à Carthage. De nombreuses autres statuettes figurant des musiciennes, des danseuses et des acteurs présentent un intérêt documentaire et esthétique certain.
Il est, toutefois, à noter que l’influence grandissante du monde grec, ne parvint pas à effacer l’attachement aux modèles hérités de l’Orient. Jusqu’à la veille de sa disparition, Carthage continua à décorer ses moules dits à gâteaux de la palmette phénicienne, de l’ibis ou de l’œil « oudja ». Par ailleurs, considérés comme de véritables pionniers dans l’art de façonner le verre, les Carthaginois s’illustrèrent par une production aussi riche que diversifiée dans ce domaine ainsi que par une qualité artistique remarquable. Leur maîtrise des divers procédés de fabrication se constate dans toutes sortes d’amphorettes, d’œnochoés, d’aryballes et d’alabastres, inspirés de prototypes grecs et servant de vases à parfum ou à fard.

Leur décor en filets concentriques se transformant parfois en ondulations ou en bandes de chevrons est rehaussé de couleurs chatoyantes où le jaune, le blanc et le turquoise se détachent sur fond bleu, noir ou brun. Le même souci esthétique se remarque dans les masques pendentifs en miniature fortement « typés » et fidèles au fond artistique oriental avec leurs visages au teint blanc, jaune ou bleu, leurs yeux écarquillés, leurs sourcils abondants et leurs barbes en forme de tortillons. Ils semblent représenter des divinités puniques appelées à protéger les vivants qui les portent dans des colliers et les morts auprès desquels on les déposait. Le verre servait également à fabriquer toutes sortes d’animaux et de volatiles, ainsi que de grosses perles polychromes, des clochettes, des grappes de raisin et divers autres éléments de colliers.
Enfin, il convient de rappeler le grand attachement des Carthaginois aux amulettes et aux bijoux. Là encore, l’influence de l’Egypte et de l’Orient est prépondérante comme on peut le voir à travers ces amulettes multiformes où apparaissent souvent l’œil « Oudja », l’uraeus, le dieu Ptah-Patèque, Bès et Anubis ou les scarabées et scaraboïdes et autres motifs constituant des talismans censés protéger les vivants et surtout les morts. Les bijoux en or, en argent ou en pierres précieuses se réfèrent tantôt à l’Egypte avec des motifs classiques d’uraei, de croissants lunaires ou de disques solaires tantôt à la Phénicie avec les boucles d’oreilles en « nacelle », les bracelets en or tressé, ou les perles avec décor en filigrane.
Des éléments phénicisants sont également présents sous forme de fleur de lotus, de palmette et d’arbre de vie sur des coquilles d’œufs d’autruche retrouvées en abondance dans les nécropoles et qui sont généralement décorées d’un visage aux yeux immenses destinés à veiller sur le mort, soit de motifs inspirés du monde animal ou végétal. Si tous les éléments qui viennent d’être évoqués montrent que Carthage a été d’un apport considérable à la vie artistique du monde antique, les données deviennent moins nombreuses quand il s’agit de mesurer l’importance de son rôle sur le plan intellectuel. Sa fin dramatique a été, comme on le sait, à l’origine de l’incendie de ses bibliothèques et au pillage et à la dispersion de ses manuscrits.
Affirmer, comme on n’a pas hésité à le faire, que les Puniques étaient essentiellement des commerçants et des hommes d’affaires peu enclins aux activités intellectuelles, est une attitude peu objective que même les données incomplètes qui nous sont parvenues dans ce domaine, permettent de nuancer considérablement. Il suffît de rappeler, à cet égard, que les Carthaginois ont hérité de leurs ancêtres phéniciens l’alphabet qu’ils ont eu le mérite de diffuser en Méditerranée occidentale. Le punique, sans supplanter tout à fait les langues autochtones, connut une très large diffusion sur toute l’étendue de l’empire carthaginois et dans ses zones d’influence. Il devint la langue officielle des royaumes numides et maures qui l’utilisèrent pour les légendes de leurs monnaies.
L’influence de l’alphabet punique sur le libyque fut également considérable. Mais l’apport punique dépassait largement ce niveau de base pour s’étendre à d’autres domaines de la vie spirituelle comme l’avait noté saint Augustin qui affirmait que les livres puniques étaient pleins de science et de sagesse « comme le rapportent les docteurs les plus savants ». Scipion Emilien en avait offert une bonne partie aux princes numides, après la chute de Carthage. Les auteurs grecs et latins y puisèrent de nombreux renseignements sur le Maghreb antique et notamment sur les campagnes militaires d’Hannibal décrites par ses deux professeurs grecs Sosylos et Silénos. De même, Salluste y trouva de quoi enrichir sa Guerre de ]ugurtha en données diverses ethnographiques et historiques.
Cependant, l’œuvre carthaginoise la plus remarquable, dans l’état actuel de nos connaissances, demeure l’ouvrage de Magon qui est un traité d’agronomie en vingt-huit livres consacrés à l’agriculture et à l’élevage et contenant des recommandations techniques qui ont dû contribuer largement à \a prospérité des campagnes carthaginoises. L’agronome latin Columelle considérait Magon comme le père de la science rurale. Ses travaux faisaient alors autorité chez les Grecs et les Romains et leur réputation dépassait de loin celle de tous les écrits antiques en la matière au point que le Sénat romain décida de les traduire en latin en dépit de l’existence, à Rome, d’un ouvrage semblable composé par Caton.
Ce livre fut véritablement un classique dont les enseignements ne se limitèrent pas à la seule antiquité selon le grand historien du Maghreb ancien, Stéphane Gsell qui a écrit : « Si l’on avait le texte de Magon, l’on constaterait sans doute aussi que ses enseignements s’étaient transmis . aux Arabes par l’intermédiaire des géopolitiques, peut-être aussi par d’autres traités grecs, traduits en syriaque, en persan et en arabe ». On peut signaler aussi un autre Carthaginois, Hasdrubal, qui parvint à une certaine notoriété intellectuelle à Athènes et qui, en 129 avant J.-C., se hissa sous le nom grec de Clitomaque, à la tête de l’Académie d’Athènes. Ville cosmopolite, largement ouverte au grand commerce, Carthage était un haut lieu de brassage social et culturel et ses habitants étaient polyglottes.
Extrai du livre “HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA TUNISIE: Tome I (Khaled Belkhoja, Abdelmajid Ennabli, Ammar Mahjoubi, Hédi Slim)