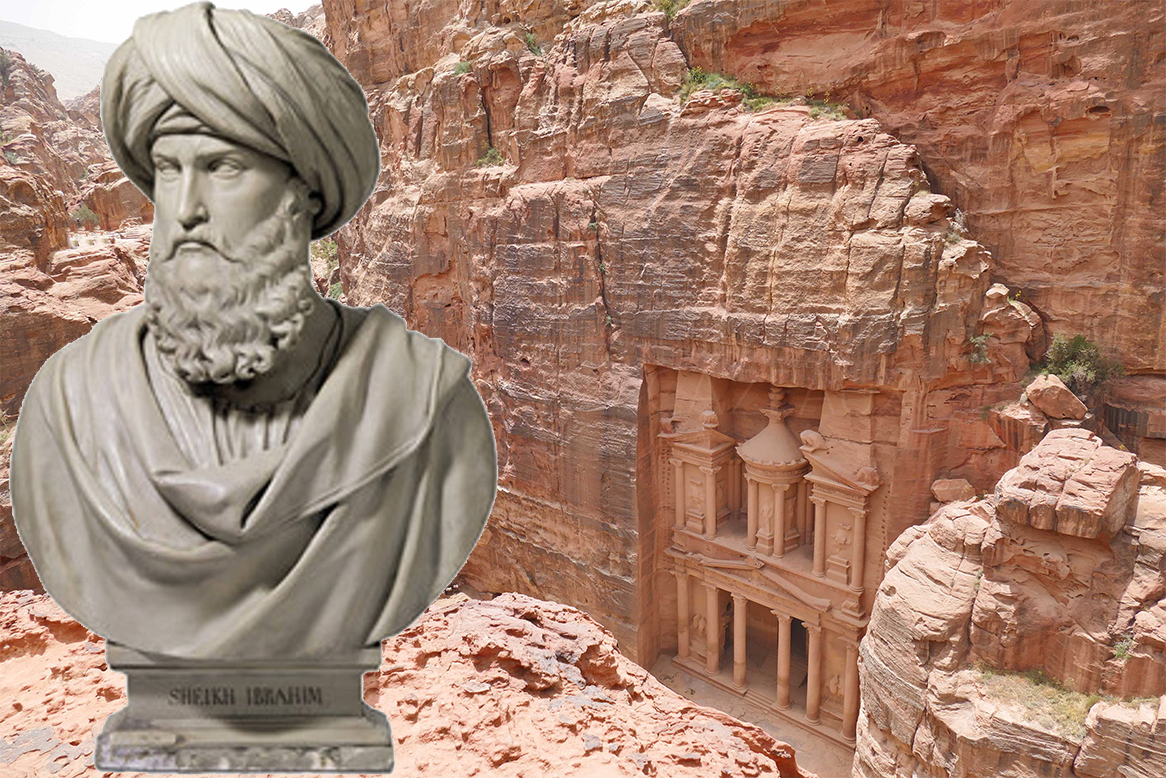Écrit par : Guy Fitoussi
Publié, le 18.01.2011 (sur son blog)
A l’occasion de la révolution tunisienne dite “du jasmin”, qu’il nous soit permis de rappeler quelques éléments de l’histoire tunisienne, liée inexorablement à celle de la communauté juive dans ce pays puis sa dispersion dans les pays occidentaux.
Le 12 mai 1881, un traité institue le protectorat de la République française sur la Tunisie, une régence ou province autonome de l’empire ottoman.
C’est l’aboutissement de manigances politiques, diplomatiques et financières qui ont complètement échappé à l’opinion publique française, laquelle découvre du jour au lendemain que son empire colonial s’est encore agrandi.
Mais le protectorat tunisien est aussi lourd de conséquences. Pour le gouvernement français, il apparaît comme une première revanche sur le destin après la guerre franco-prussienne. Mais à l’Angleterre, il fournit le prétexte à une mainmise sur l’Égypte. Et pour l’ensemble des pays européens, il amorce le partage de l’Afrique puis du Proche-Orient suite à la chute de l’Empire ottoman.
La Tunisie, au début du XIXe siècle, est gouvernée par un bey indépendant de fait du sultan d’Istamboul. En 1830, il voit avec quelque inquiétude la France occuper l’Algérie voisine. Son inquiétude grandit quand, en 1835, le sultan rétablit par la force son autorité sur la Libye voisine.
Le pays recense alors un million d’habitants dont une moitié d’agriculteurs, sur la côte, et une autre moitié de bergers nomades. À Tunis et Kairouan, qui comptent respectivement 100.000 et 15.000 habitants, l’artisanat traditionnel tente de résister à la concurrence occidentale.
Sous le règne du médiocre Mohammed es-Sadok, de 1859 à 1882, il souffre de famines, de mauvaises récoltes et d’épidémies de choléra, ce qui met à mal les tentatives de réforme du bey et de ses prédécesseurs.
La France prend pied dans la régence en 1869, par le biais d’une commission Anglo-italo-française destinée à résorber la dette extérieure de l’État.
Mais le Premier ministre Khair-Eddine (on écrit aussi Khair-Eddine ou Khayr al-Dîn) réussit à rétablir les finances et entreprend avec un certain succès une nouvelle et vaste politique de réformes.
Les Européens n’auraient-ils plus rien à faire dans ce pays ? Absolument pas ! Entre-temps, au congrès de Berlin de 1878, la France a obtenu l’accord tacite des autres puissances européennes pour renforcer sa présence en Tunisie avec pour justification de protéger la colonie voisine d’Algérie.
Le 24 avril 1881, sur ordre du chef du gouvernement Jules Ferry, un corps expéditionnaire de 35.000 hommes traverse la frontière, officiellement pour poursuivre des montagnards khoumirs qui sèment le trouble en Algérie.
Le 12 mai, ils arrivent à proximité du Bardo, dans la banlieue de Tunis, , où se situe le palais du bey et laissent à celui-ci deux heures pour examiner un projet de traité en dix articles qui met fin à l’indépendance de la Tunisie. Mohammed es-Sadok n’a guère d’autre choix que de se soumettre.
C’est ainsi qu’il signe en son palais de Kassar-Saïd un traité par lequel il confie à la France les affaires étrangères, la défense du territoire et la réforme de l’administration. De fait, il se place sous la « protection » de la France même si la Tunisie ne devient officiellement un « protectorat » que le 8 juin 1883, à la signature du traité de La Marsa, qui confirme le précédent et donne à la France le droit d’instaurer des « réformes administratives, judiciaires et financières ».
Après la soumission de la Tunisie, la France est naturellement portée à regarder avec concupiscence du côté du Maroc, dernier État d’Afrique du Nord qui ne soit pas encore passé sous tutelle française.
Mais le traité du Bardo soulève aussi l’irritation de l’Italie qui se serait bien vue protectrice de la Tunisie, si proche d’elle. Du coup, Rome signe le 20 mai 1882 avec Berlin et Vienne le traité de la Triple-Alliance par lequel l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie se promettent aide et assistance en cas d’agression par la France ou la Russie. Ce traité sera régulièrement renouvelé jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale.
Quant à l’Angleterre, l’éternelle rivale, elle prend prétexte de ce traité pour précipiter sa propre intervention dans les affaires égyptiennes. Dès l’année suivante, elle établit son protectorat sur cette ancienne province ottomane, prélude à l’établissement du mandat britannique en Palestine puis de la création de l’Etat d’Israël grâce à l’aide des empires coloniaux (déclaration Balfour en 1917), mais aussi des pays arabes (correspondance Hussein-Mac Mahon en 1915).
Comment se situe l’attitude des Juifs de Tunis à cette même époque. Entre Orient et Occident, qui choisir ? C’est ce que nous essaierons de vérifier dans la suite.
Lors de la prise de Tunis par les Espagnols en 1535, de nombreux Juifs sont faits prisonniers et vendus comme esclaves dans plusieurs pays chrétiens. Après la victoire des Ottomans sur les Espagnols en 1574, la Tunisie devient une province de l’Empire ottoman dirigée par des deys, à partir de 1591, puis par des beys, à partir de 1640. Dans ce contexte, les Juifs arrivés en provenance d’Italie joueront peu à peu un rôle important dans la vie du pays et dans l’histoire du judaïsme tunisien.
Dès le début du XVIIe siècle, des familles marranes rejudaïsées après leur établissement à Livourne à la fin du XVe siècle, quittent la Toscane pour s’installer en Tunisie, dans le cadre de l’établissement de relations commerciales. Ces nouveaux arrivants, appelés Granas en arabe et Gorneyim (גורנים) en hébreu, sont plus riches et moins nombreux que leurs coreligionnaires indigènes, dénommés Twansa. Ils parlent et écrivent le toscan, parfois encore l’espagnol, et constituent une élite économique et culturelle très influente dans le reste de la communauté italienne. Leurs patronymes rappellent leur origine espagnole ou portugaise. Rapidement introduits auprès de la cour beylicale, ils exercent des fonctions exécutives de cour — collecteurs de taxes, trésoriers et intermédiaires sans autorité sur des musulmans — et des professions nobles dans la médecine, la finance ou la diplomatie.
Même s’ils s’installent dans les mêmes quartiers, ils n’ont quasiment aucune relation avec les Twansa, auxquels des Juifs du reste du bassin méditerranéen se sont assimilés. Les Twansa parlent le dialecte judéo-tunisien et occupent une position sociale modeste. C’est pourquoi, contrairement à ce qui se passe ailleurs dans le Maghreb, ces nouvelles populations ne sont guère acceptées, ce qui conduit peu à peu à la division de la communauté juive en deux groupes.
Dans ce contexte, les Juifs jouent un grand rôle dans la vie économique du pays, dans le commerce et l’artisanat mais aussi dans le négoce et la banque. Malgré les droits de douane supérieurs à ceux payés par les commerçants musulmans ou chrétiens (10 % contre 3 %), les Granas parviennent à contrôler et faire prospérer le commerce avec Livourne. Leurs maisons de commerce pratiquent en outre des activités bancaires de crédit et participent au rachat des esclaves chrétiens capturés par des corsaires et revendus à profit. Les Twansa se voient quant à eux concéder le monopole du commerce du cuir par les beys mouradites puis husseinites. Juifs livournais comme tunisiens travaillent dans le commerce de détail au sein des souks de Tunis, écoulant ainsi les produits importés d’Europe sous la houlette d’un Amin musulman, ou dans le quartier juif.
En 1710, un siècle de frictions entre les deux groupes conduit à un coup de force de la communauté livournaise, avec un accord tacite des autorités. En créant ses propres institutions communautaires, elle provoque un schisme avec la population autochtone. Chacune possède désormais son conseil de notables, son grand rabbin, son tribunal rabbinique, ses synagogues, ses écoles, sa boucherie et son cimetière distincts. Cet état de fait est entériné par une taqqana (décret rabbinique) signée en juillet 1741 entre les grands rabbins Abraham Taïeb et Isaac Lumbroso. Cet accord sera renouvelé en 1784 avant d’être annulé en 1899. Cette taqqana fixe, parmi d’autres règles, le fait que tout Israélite originaire d’un pays musulman est rattaché aux Twansa tandis que tout Israélite originaire d’un pays chrétien l’est aux Granas. De plus, les Granas — communauté plus riche bien que ne constituant que 8 % de la population globale — assurent désormais un tiers du paiement de la jizya contre deux tiers pour les Twansa. Ce dernier point indique que la communauté livournaise, auparavant protégée par les consuls européens, s’est suffisamment intégrée en Tunisie pour que ses membres soient considérés comme dhimmis et taxés comme les Twansa.
Les différences socioculturelles et économiques entre ces deux communautés ne font que se renforcer au XIXe siècle. Les Granas, en raison de leurs origines européennes et de leur niveau de vie plus élevé mais aussi de leurs liens économiques, familiaux et culturels conservés avec Livourne, supportent difficilement de côtoyer leurs coreligionnaires autochtones, considérés comme moins « civilisés », et de payer des contributions importantes alors qu’ils ne représentent qu’une minorité des Juifs de Tunisie. De l’autre côté, les élites autochtones ne souhaitent pas abandonner leur pouvoir aux nouveaux venus, contrairement à ce que firent leurs voisins maghrébins, sans doute en raison de l’arrivée plus tardive des Granas en Tunisie. Les Granas se démarquent aussi géographiquement des Twansa, en s’installant dans le quartier européen de Tunis, évitant ainsi la Hara, et se rapprochent culturellement plus des Européens que de leurs coreligionnaires. Pourtant, les deux groupes gardent les mêmes rites et les mêmes usages à quelques variantes près et, hors de Tunis, les mêmes institutions communautaires continuent à servir l’ensemble des fidèles. De plus, l’ensemble des Juifs reste placé sous l’autorité d’un seul caïd choisi parmi les Twansa, sans doute pour éviter les interférences avec l’étranger.
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les Juifs font toujours l’objet de brimades et de mesures discriminatoires, notamment de la part du système judiciaire qui se montre arbitraire à leur égard, à l’exception toutefois des tribunaux hanéfites plus tolérants. Les Juifs sont toujours astreints au paiement collectif de la jizya — dont le montant annuel varie selon les années, de 10 332 piastres en 1756 à 4 572 piastres en 1806 — et doivent s’acquitter d’impositions supplémentaires (ghrâma) chaque fois que le trésor du souverain est en difficulté, comme le font parfois aussi les musulmans. De plus, ils sont périodiquement astreints à des travaux d’utilité publique et se voient imposer des corvées qui touchent principalement les plus pauvres des communautés. Au plan vestimentaire, la chéchia qui leur sert de coiffe doit être de couleur noire et enveloppée d’un turban sombre, à la différence des musulmans qui portent une chéchia rouge entourée d’un turban blanc. Les Granas, qui s’habillent à l’européenne, portent pour leur part des perruques et des chapeaux ronds comme les marchands chrétiens.
Au début du XVIIIe siècle, le statut politique des Juifs s’améliore quelque peu grâce à l’influence croissante des agents politiques des puissances européennes qui, cherchant à améliorer les conditions de vie des résidents chrétiens, plaident également la cause des Juifs que la législation musulmane classe ensemble. Mais, si les Juifs aisés — qui exercent des charges dans l’administration ou dans le négoce — parviennent à se faire respecter, notamment via la protection de personnalités musulmanes influentes, les Juifs démunis sont souvent victimes de brimades, voire assassinés sans que les autorités ne semblent intervenir. Un observateur déclare qu’on les reconnaît « non seulement à leur costume noir mais encore à l’empreinte de malédiction qu’ils portent sur leur front ».
Toutefois, au-delà de ce climat difficile, les Juifs ne font pas l’objet d’explosions de fanatisme religieux ou de racisme conduisant à des massacres. Même si des pillages accompagnés de violences sont parfois signalés, ils se déroulent toujours dans un contexte de troubles touchant aussi le reste de la population comme en juin 1752 et septembre 1756 à Tunis. De plus, on n’assiste à aucune expulsion massive et les Juifs disposent d’une liberté de culte presque totale — associant souvent leurs voisins musulmans à leurs fêtes — contrairement à ce qui se pratique alors en Europe.
À la fin du XVIIIe siècle, Hammouda Pacha refuse aux Juifs le droit d’acquérir et de posséder des propriétés immobilières alors que l’apprentissage de l’arabe littéral et l’usage de l’alphabet arabe leur auraient aussi été interdits durant cette période. Enfin, quant au comportement de la population musulmane à l’égard des communautés, il varie de la volonté d’application rigoureuse de la dhimma pour les oulémas à l’absence d’hostilité de la population rurale, en passant par les violences de certaines franges urbaines marginalisées mais assurées de l’impunité.
L’inclusion des Juifs dans la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen, le 27 septembre 1791, et les décrets napoléoniens de 1808 suscitent une certaine sympathie pour la France parmi les Juifs de Tunisie qui sont tous sujets du bey. Ainsi, le chargé d’affaires espagnol rapporte en 1809 que « les Juifs sont les plus acharnés partisans de Napoléon ». On rapporte même que certains Juifs, y compris des Granas, portaient à cette époque une cocarde tricolore, acte sévèrement réprimé par Hammouda Pacha, qui refuse toute tentative de la France de prendre sous sa protection ses sujets juifs originaires de la Toscane nouvellement conquise par Napoléon. C’est dans ce contexte que l’article 2 du traité du 10 juillet 1822, signé avec le Grand-duché de Toscane, fixe la durée du séjour des Granas en Tunisie à deux ans ; au-delà, ils passent sous la souveraineté du bey et sont considérés sur le même plan que les Twansa.
Dès lors, l’action politique est vue comme un moyen pouvant mettre fin au statut d’exception frappant les Juifs, constituant « une véritable rupture dans l’univers mental des communautés juives, rupture qui brise le vieux monde de la soumission à l’ordre des choses » (Jacques Taïeb, « Réalité et perception de la condition juive en Tunisie (1705-1857) : un modèle maghrébin ? », p. 129). En 1853, le caïd de la communauté tunisienne, Nessim Samama, obtient l’abolition des corvées auxquelles ses coreligionnaires étaient jusqu’alors contraints. Malgré tout, les Juifs restent soumis au paiement de la jizya et de taxes exceptionnelles réclamées par le bey selon les besoins et font aussi l’objet de discriminations. Sur le plan vestimentaire, ils sont contraints de porter une chéchia noire et non rouge, un turban noir ou bleu foncé et non blanc et des chaussures noires et non de couleur vive. Ils ne peuvent vivre hors des quartiers qui leur sont attribués et ne peuvent accéder à la propriété immobilière. Enfin, lorsqu’ils sont les victimes de vexations ou de violences, ils ne reçoivent pas de réparation pour le tort subi.
Pourtant, la relation entre Juifs et Arabes se transforme radicalement à partir du milieu du siècle, du fait de l’irruption en Tunisie de puissances coloniales européennes, et en particulier la France. En effet, celles-ci s’appuient sur la présence de Juifs pour promouvoir leurs intérêts économiques et commerciaux : la situation de ceux-ci, souvent traités de manière inéquitable par les tribunaux tunisiens, sert de prétexte à des pressions sur le bey. L’affaire Sfez en 1857 est une illustration de ce nouveau contexte et l’occasion pour la France et le Royaume-Uni d’intervenir au nom de la défense des droits de l’homme et du combat contre l’absolutisme et le fanatisme afin de favoriser leurs entreprises.
Batou Sfez est un cocher juif au service du caïd de sa communauté, Nessim Samama. À la suite d’un incident de circulation et à une altercation avec un musulman, il est accusé par ce dernier d’avoir injurié l’islam ; des témoins confirment par la suite devant notaire avoir assisté à la scène. Inculpé et jugé coupable, selon le droit malikite et malgré ses protestations, il est condamné par le tribunal du Charaâ à la peine de mort pour blasphème et décapité à coup de sabre le 24 juin. Le souverain Mohammed Bey cherche par ce geste à apaiser les rancœurs nées de l’exécution d’un musulman accusé d’avoir tué un Juif et à prouver que sa justice traite ses sujets équitablement. Néanmoins, la rigueur de la peine soulève une vive émotion dans la communauté juive et chez les consuls de France et du Royaume-Uni, Léon Roches et Richard Wood. Ceux-ci en profitent alors pour exercer une pression sur le souverain afin qu’il s’engage dans la voie de réformes libérales similaires à celles promulguées dans l’Empire ottoman en 1839. D’ailleurs, l’historien Ibn Abi Dhiaf évoque les Juifs tunisiens comme des « frères dans la patrie » (Ikhwanoun fil watan), même s’il reproche à certains d’entre eux de rechercher la protection des consuls étrangers avec exagération.
L’arrivée d’une escadre française en rade de Tunis oblige le bey à proclamer le Pacte fondamental le 10 septembre 1857, avec l’appui d’Ibn Abi Dhiaf semblant représenter l’attitude la plus favorable à l’égard des Juifs parmi les réformateurs, alors que d’autres sont plus sceptiques. Le texte change radicalement la condition des non musulmans : les Juifs tunisiens, considérés jusque-là comme des sujets de second rang, échappent au statut séculaire de la dhimma.
Toutefois, la hausse des dépenses publiques engendrées par les nouvelles institutions et de nombreux travaux publics conduit à une hausse de la mejba et à une révolte en avril 1864, la crise étant aggravée par des détournements de fonds et la dégradation des conditions économiques. Des attaques ont alors lieu contre les Juifs — accusés de profiter de ces réformes — ou leurs biens à Sousse, Gabès, Nabeul, Sfax et Djerba. Même si la constitution est suspendue dès les premiers jours de la révolte, finalement réprimée, les réformes précédentes restent en vigueur et les Juifs lésés sont indemnisés par le pouvoir. Néanmoins, les juridictions tunisiennes continuent de faire preuve d’une particulière sévérité à l’égard des Juifs dont les notables se tournent vers les consuls et des Juifs sont toujours l’objet de crimes restés impunis. Le pays devient le théâtre des luttes d’influence entre les nations européennes qui confèrent à certains notables des patentes de protection qui leur permettent, tout en conservant la nationalité tunisienne de se placer sous la protection des juridictions consulaires ; les principales puissances européennes qui y sont les plus favorables peuvent ainsi justifier leurs interventions dans les affaires intérieures du pays.
Les pressions de la France, qui trouve auprès de l’élite juive autochtone un médiateur réceptif, mais aussi de l’Italie et du Royaume-Uni, conduisent finalement à ce que le bey donne son accord pour l’ouverture d’une école de garçons à Tunis, effective le 7 juillet 1878, dirigée par David Cazès. L’ensemble du programme public français y est enseigné, dont le français, ainsi que l’hébreu et l’histoire juive, répondant ainsi aux attentes des familles souhaitant concilier enseignement moderne et culture traditionnelle. La prise en charge des enfants pour les repas, les vêtements, etc. contribue à accroître les effectifs, même si les écoles publiques continuent à accueillir le plus grand nombre d’élèves. Quant à la suppression rapide de l’italien, elle se fait au détriment de la communauté livournaise qui tente alors de promouvoir les intérêts politiques italiens et qui joue le rôle de modèle que les Twansa s’efforcent d’imiter en empruntant la voie de la culture française. Un système d’apprentissage de quatre ans est aussi mis en place pour former des jeunes à divers métiers — menuisier, tapissier, forgeron, carrossier, horloger, électricien ou peintre — afin qu’ils occupent un emploi salarié ou s’établissent à leur compte.
Cette concurrence produit une émulation entre les élites respectives et peut expliquer le dynamisme de la scolarisation des jeunes Juifs. Après cette école de garçons, une autre voit le jour à La Goulette en 1881, puis une école de filles (1882), une école maternelle de filles (1891) et une école mixte (1910) ouvrent à Tunis ; d’autres écoles ouvrent en 1883 à Sousse et Mahdia et en 1905 à Sfax. Une école agricole de garçons est également fondée en 1895 à Djedeida mais, n’attirant pas suffisamment de locaux, les élèves proviennent de Tripolitaine, d’Algérie et du Maroc. Pour la première fois, les filles sont donc scolarisées ce qui rompt avec la société juive traditionnelle.
Dans ces écoles de l’AIU (Alliance Israélite Universelle) accueillant près de 3 500 élèves des deux sexes à la veille de la Première Guerre mondiale, outre l’apprentissage fondamental du français, c’est surtout un nouveau système de valeurs qui est transmis aux élèves, en opposition aux tenants de la tradition au sein de la communauté. Par ailleurs, les écoles chrétiennes, catholiques ou protestantes, ouvertes à Tunis dans la seconde moitié du XIXe siècle attirent de plus en plus d’enfants des familles juives les plus éclairées. Ce processus s’étale dans le temps, de la classe la plus aisée jusqu’à certains des plus modestes éléments de la communauté.
Cependant, toutes les communautés locales n’évoluent pas au même rythme, et certaines ne sont que très faiblement concernées. Des difficultés sont rencontrées, comme à Bizerte, Béja et Mahdia, où les communautés ne peuvent fournir la contribution financière demandée. Quant aux Juifs de Djerba, ils refusent l’ouverture d’une école de l’AIU, comme ils boycottent déjà l’enseignement séculier instauré par les autorités françaises, malgré les pressions des notables juifs de la capitale et du caïd local et l’usage de la force; cette décision est un exemple rare et peut-être unique dans l’histoire de l’AIU. En effet, les rabbins frappent d’excommunication tout membre de la communauté qui coopérerait avec elle car, prenant l’exemple de Tunis où ils perçoivent un déclin du savoir et de la pratique religieuse, ils considèrent la proposition comme une atteinte à l’intégrité de leur communauté, lui préférant le système traditionnel d’enseignement rabbinique obligatoire pour les seuls garçons. En retour, les autorités du protectorat et les notables juifs de la capitale désignent longtemps les Djerbiens comme des « communautés arriérées, maintenues dans l’abjection et l’ignorance par des rabbins réfractaires à tout progrès »[Lucette Valensi et Abraham L. Udovitch, Juifs en terre d’islam : les communautés de Djerba, éd. Archives contemporaines, Paris, 1991, pp. 20-21].
Avec l’établissement du protectorat français en Tunisie en 1881, une ère nouvelle s’ouvre pour les Juifs qui se trouvent face au pouvoir affaibli du bey et à celui dominant de la France. Une grande partie d’entre eux ont alors espoir de se soustraire à la domination auxquels ils sont assujettis depuis la conquête musulmane du Maghreb. Néanmoins, les Juifs seront quelque peu déçus par le nouveau pouvoir qui ne répondra pas toujours favorablement à leurs attentes.
Dans un premier temps, les Juifs ne souffrent pas d’antisémitisme de la part des nouveaux arrivants. Pourtant, le journal La Tunisie française se livre à de régulières attaques. De plus, du 26 au 29 mars 1898, une rixe entre Juifs et Arabes dégénère en émeutes durant lesquelles les Juifs sont molestés, leurs maisons pillées et leurs magasins mis à sac sans que la police n’intervienne. Malgré les condamnations prononcées, la responsabilité des troubles n’a jamais été clairement établie. Le contexte troublé de l’affaire Dreyfus ajoute encore à la crainte d’une explosion de violence ; sa résolution contribue toutefois à renforcer l’attachement des Juifs à la France et les encourage à présenter des revendications.
Si la présence française entraîne une francisation continue de la communauté juive, le rapprochement souhaité par ses élites ne se fait pas sans difficultés. L’extension de la juridiction française aux Juifs tunisiens accompagnée par la suppression du tribunal rabbinique et la possibilité de naturalisations individuelles deviennent des revendications prioritaires de l’intelligentsia moderniste ayant accédé aux universités françaises. Elles sont exposées pour la première fois par Mardochée Smaja en 1905, puis défendues dans l’hebdomadaire La Justice fondé en 1907. Si les représentants des Français de Tunisie soutiennent ces idées, l’administration du protectorat, le gouvernement français de la Troisième République et les instances rabbiniques conservatrices appuyées par les fractions les plus populaires de la communauté les combattent. Les musulmans modernistes critiquent eux une atteinte à la souveraineté et la création d’une inégalité entre ressortissants d’un même État.
En raison de sa position socioculturelle intermédiaire, l’élite juive autochtone francisée s’identifie aux valeurs républicaine et laïque pour refuser l’ordre arabe et musulman existant. Cette position permet à la fois de viser la promotion sociale et culturelle de la communauté et le maintien d’une identité forte grâce à un partenariat avec d’autres communautés et à la garantie offerte par la France. L’idéologie de l’école républicaine suscite aussi un grand enthousiasme au sein de la communauté. En effet, la culture universaliste transmise permet d’éluder la question nationale tout en offrant une échappatoire à la domination via la promotion socioprofessionnelle, après des siècles de relative stagnation, et l’acquisition d’un statut social plus valorisé. Le décloisonnement relatif de la société, avec l’apparition de lieux de sociabilité indépendants comme l’école, les cafés, le théâtre ou les clubs sportifs, participent de l’affranchissement des individus par rapport à leur groupe et leur religion et du délaissement des formes traditionnelles de la culture judéo-arabe qui perdurent toutefois dans les communautés de l’arrière-pays. Si de nouvelles synagogues sont construites dans toutes les villes, un net recul de la pratique religieuse est constaté, même si cela reste encore le fait d’une minorité parmi les plus aisés et les instruits. Ce phénomène est associé à une diminution de la connaissance de l’hébreu liée à l’absence de son enseignement dans l’école publique, où se rend une large majorité des enfants des deux sexes, même si le Talmud Torah n’a pas disparu dans les grandes villes.
Dès la fin du siècle, les familles disposant de ressources financières suffisantes font poursuivre des études secondaires voire supérieures à leurs enfants. Dans le même temps, la communauté prospère en profitant de l’économie coloniale. Même si les Juifs exercent toujours les métiers traditionnels du commerce, du négoce et de l’artisanat, les jeunes sortant des écoles et des centres d’apprentissage se font de plus en plus embaucher dans les ateliers, les magasins et les bureaux. Ils intègrent aussi le réseau de succursales de banques et d’assurances installées par des sociétés françaises, se lancent dans de nouveaux métiers, participent à la création des premières industries ou constituent des exploitations agricoles. La part d’employés augmente considérablement car les jeunes qui ont acquis la connaissance du français maîtrisent suffisamment le dialecte arabe pour servir d’intermédiaires entre leurs patrons français et leurs clients tunisiens.
Les enfants de la génération suivante sont poussés à aller au-delà de l’instruction primaire et accèdent aux professions libérales, après une formation en France ou en Italie, de médecins, de pharmaciens ou d’avocats. Les familles juives occidentalisées abandonnent alors leurs habitations traditionnelles (oukalas) de la Hara pour s’installer dans des appartements individuels en bordure de celle-ci ou, pour les plus aisés, dans les nouveaux quartiers européens de Tunis. Ces transformations économiques conduisent à une restructuration de la société juive : une bourgeoisie commerciale, industrielle voire agricole, une bourgeoisie libérale (avocats, médecins, pharmaciens et architectes), une classe moyenne (commerçants, artisans, employés et fonctionnaires), une classe ouvrière encore réduite et une masse de journaliers sans qualification, de malades et d’infirmes aux moyens très modestes qui ne survivent que par les subsides de la communauté ; ces derniers se retrouvent notamment dans la Hara de Tunis.
La scolarisation participe aussi de l’acculturation des nouvelles générations. Ainsi, le français devient la langue maternelle au même titre que l’arabe, quand il ne le remplace pas, et permet au quotidien l’émancipation et la mobilité sociale des individus. Dans le même temps, l’adoption de prénoms européens aux dépens des prénoms hébreux ou arabes, l’adoption du vêtement européen, l’acceptation des rythmes de travail hebdomadaires, la distanciation à l’égard des croyances et pratiques superstitieuses partagées avec les musulmans se répandent. Les femmes s’émancipent aussi par le changement de costume, mais à moins vive allure que les hommes et avec des décalages intergénérationnels et intrafamiliaux. Simultanément, l’autorité maritale et paternelle se module du fait du développement de l’instruction féminine, de la diffusion croissante des valeurs modernistes et de la plus grande instruction des nouvelles générations. De plus, l’âge au mariage se relève, les unions consanguines se font plus rares et celles entre Twansa et Granas plus fréquentes, la famille nucléaire s’éloigne de la famille élargie, etc.
Pour expliquer le départ des Juifs de Tunisie, Lucette Valensi rappelle que l’intégration à la société et à la culture dominantes n’était pas possible dans un État se proclamant arabe et musulman, une sécularisation ayant signifié la disparition de la communauté devenue une simple minorité. Même si, pour Claude Tapia, « attribuer des causes ponctuelles à ce vaste mouvement de population […] ne rend pas compte du phénomène dans la totalité de ses dimensions ou de sa signification »[Claude Tapia, « Ruptures et continuités culturelles, idéologiques, chez les juifs d’origine tunisienne en France », Juifs et musulmans de Tunisie. Fraternité et déchirements, p. 349], Catherine Nicault estime que c’est probablement « parce qu’ils n’ont pas cru possible d’échapper au courant d’une histoire partout défavorable aux minoritaires dans les nouvelles nations arabes en formation, plus que pour toute autre raison conjoncturelle, que les Juifs de Tunisie ont décidé finalement » de quitter le pays[Catherine Nicault, « Les relations judéo-musulmanes en Tunisie. Rapport de synthèse », Juifs et musulmans de Tunisie. Fraternité et déchirements, p. 417]. Pour Haïm Saadoun, la situation au Proche-Orient a eu une influence marginale même si certains événements ont pu constituer un élément déclencheur du départ des Juifs. En réaction à ce départ émergent l’incompréhension et la perplexité des Tunisiens musulmans, d’où le chef d’accusation traditionnel de l’« ingratitude juive ».
En France, les arrivants se divisent entre une bourgeoisie francisée et une population plus modeste et moins occidentalisée. Ils connaissent des trajectoires différentes de celles de leurs coreligionnaires d’Algérie, devenus citoyens français depuis le décret Crémieux, puisqu’une partie d’entre eux sont des citoyens tunisiens, ce qui en fait des réfugiés et non des rapatriés. Mais ils reçoivent largement permis de séjour et cartes de travail, ce qui leur permet de retrouver une activité professionnelle, avant d’envisager une naturalisation. Installés à Paris (quartiers de Belleville et Montmartre), ils entament pour certains une migration vers les banlieues, au milieu des années 1960, comme à Sarcelles où ils représentent 56 % de la population juive en 1970, mais aussi à Massy, Antony, La Courneuve ou Créteil. Ils sont également nombreux dans le sud du pays (Marseille, Nice, Cannes, Montpellier, Toulouse) et la région Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble).
Comme les autres Juifs orientaux, ceux qui émigrent en Israël travaillent comme main d’oeuvre dans l’agriculture, l’industrie et les services. Installés d’abord en Galilée et dans le Néguev, ils se retrouvent de nos jours à Jérusalem, Haïfa et Tel Aviv, Kiryat Shmona, Beït Shéan, Netivot, Ramla, Beer-Sheva et Dimona. Gardant des aspects de leur culture d’origine, certains continuent de célébrer les anniversaires de Rabbi Shimon bar Yohaï ou Rabbi Meïr auxquels sont associés les rabbins tunisiens ; un pèlerinage connu sous le nom de Hiloula du Néguev est aussi organisé sur la tombe d’un ancien rabbin de Gabès, Haïm Houri, inhumé à Beer-Sheva.
Conclusion
La séparation entre Grana et Twansa fut reconnue officiellement en 1710, et deux communautés juives autonomes virent le jour. Le terme “Livournais” englobait l’ensemble des Juifs originaires de pays chrétiens et suivant le rite portugais ou livournais. Au début du xixe siècle, le consul américain à Tunis Mordecai Noah, d’origine juive, constatait: “Les Juifs italiens s’habillent comme les habitants chrétiens, avec, en plus, un haïk, ou bournous, jeté sur les épaules. Ils habitent un quartier distinct de la ville et sont gouvernés par une personne désignée par le bey, qui entend et juge tous les litiges et ordonne, si nécessaire, d’infliger des châtiments corporels, afin que l’on puisse dire qu’ils ont le privilège d’être dirigés par des hommes de leur confession” (M. Noah, Travels in England, France, Spain, and the Barbary States in the years 1813-1814 and 15, Londres, J. Miller, 1819, p. 311). En raison du rôle des Juifs dans le commerce européen, la question de leur statut devint un problème politique majeur entre l’Europe et la Tunisie. Les Juifs de nationalité étrangère ou ceux sous la protection des consulats profitaient de leur aide pour développer leurs intérêts et échapper à la juridiction tunisienne. Fondés sur les capitulations – système de conventions entre le gouvernement ottoman et les États européens instauré au XVIe siècle pour faciliter le commerce -, les droits extraterritoriaux accordés par les consulats étrangers étaient de plus en plus souvent accusés de porter atteinte à la souveraineté de l’Etat ottoman. Avec la multiplication des interventions étrangères au XIXe siècle, ces droits furent considérés par les dirigeants husseinides comme un signe d’affaiblissement de l’Etat musulman. Un décret de 1823 reflétant cette préoccupation rendit illégal le port par les Juifs de chapeaux européens. Un incident impliquant un Juif de Gibraltar, arrêté pour avoir refusé de se plier au nouveau décret, entraîna l’envoi par les Anglais de leur flotte méditerranéenne à Tunis. Le bey fut contraint de retirer le décret, du fait qu’il s’appliquait aux Juifs de nationalité étrangère (J. Ganiage, Les Origines du protectorat français en Tunisie (1861-1881), Paris, PUF, 1959, p. 50). Les Juifs livournais étaient considérés comme des sujets du bey au même titre que les Twansa s’ils s’installaient et demeuraient effectivement à Tunis. Cependant, à l’époque de la conquête de l’Italie par Napoléon, les Juifs livournais demandèrent également la protection française. En effet, depuis le XVIIe siècle, par suite de capitulations entre la France et l’Empire ottoman, les commerçants étrangers étaient souvent considérés comme placés sous cette protection. Les États italiens se trouvant sous occupation française, la France se sentit obligée d’étendre sa protection aux Juifs livournais. En outre, de nombreux Juifs ayant l’intention de s’installer à Tunis obtinrent la nationalité française à Livourne.Au bout du compte, ce lien entre Juifs tunisiens et puissances étrangères devait attacher inextricablement la communauté juive tunisienne aux intérêts du colonialisme français. Toutefois, à la différence de l’Algérie, où la communauté juive toute entière était intégrée au système consistorial français et où tous les Juifs s’étaient vu accorder la nationalité française par le décret Crémieux (1870), les autorités françaises étaient réticentes à supprimer le statut “indigène” pour l’ensemble des Juifs tunisiens. Comme dans d’autres cadres coloniaux, la communauté juive fut subordonnée aux autorités françaises, sans parvenir toutefois à l’égalité juridique accompagnant les droits liés à la citoyenneté (sur la manière dont le passage à la domination coloniale a affecté les Juifs, voir Y. Tsur, “Takrit halvayot: Yehude Tunis be-maavar le shilton Kolonyali”, Tsiyon, 66, 2001, p. 73-102).
En fait, ce que les populations arabes avaient ressenti comme une trahison – l’adoption massive de la culture européenne par les Juifs de Tunisie – adoption liée largement au traitement souvent vexatoire que l’Islam et l’empire ottoman réservaient aux Dhimmis – ce sont les populations juives séfarades, dont celle de Tunisie – qui allaient tristement le ressentir en Israël même par rapport à une culture “européenne” ashkénaze plus vexatoire encore envers les populations dites “orientales”.
De manière assez paradoxale, ce sont les ashkénazes d’Israël qui allaient révéler – en les ostracisant – les racines profondément sémites et orientales des juifs de Tunisie et du Maghreb qui pensaient, à tort, s’être émancipé de cette culture et de ces racines “grâce” aux empires coloniaux; exactement comme l’Allemagne nazie allaient faire ressurgir le passé “sémite” d’une population qui s’estimait pourtant, à juste titre, profondément européenne.
Tout comme l’ashkénaze en Europe n’a pu échapper à son destin de Juif, le séfarade ne le pourra pas non plus.
Le défi auquel est confronté l’Etat d’Israël aujourd’hui réside précisément dans la reconnaissance de ce qu’il est véritablement: un peuple sémite résolument situé au proche-orient et qui doit composer avec ses frères arabes.
Source: Blog de l’avocat Guy Fitoussi, avec une grande partie du texte apparait sur le site: Wikipedia (Histoire des jufs de Tunisie)